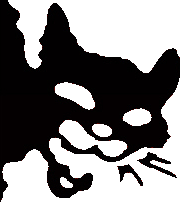Période de crise, de catastrophes, de fléau. Réfugiés, cadavres, misères. Cela dure et ne s’éclaire souvent que de soubresauts, ici ou là des individus qui se libèrent, juste un temps, avant que la matraque, le baril de chlore ou la famine ne revienne. Il y a de quoi être un brin pessimiste. Abandonner son idéal chiffonné par la réalité du malheur, renoncer à l’espoir que l’on a dans la vie d’un monde peut-être meilleur.
Avant tout ça, avant Alep, Trump, les fachos à nos portes (les ont-ils jamais quitté ?), Fillon ou Valls et j’en passe, c’était pourtant la même. On a oublié déjà les financiers et leurs triple A quand les financiers ruinaient des villes entières ; déjà oubliés les meurtres policiers quand on encensait ces parasites d’avoir courageusement fait leur métier en ne servant à rien. Et maintenant ces réfugiés dont il faut avoir peur, qu’on « puce » comme du bétail, mais avec beaucoup plus d’humanité. Mais bientôt, sur le modèle de l’Office Alimentaire Vétérinaire (OAV), évaluera t-on le bien être des réfugiés avant leur abatage1 à défaut de camp de concentration disponibles.
Demain, il y aura des statues de généraux en granit bleu dans les rues d’Alep et des rues au nom de policiers assassins. Il y a bien une avenue Thiers à Bordeaux. Le savant comme le politique expliquent à ceux qui n’ont rien compris à ce monde que c’est l’heure du nationalisme, du repli sur soi, de la peur de la mondialisation. Le pouvoir échappe ici ou là à celui qui s’en était déjà repu. Ailleurs et quelques cadavres plus tard, il revient aux dynasties autoproclamées. En commun, ces braves gens n’ont que le pouvoir qu’on leur laisse bien volontiers, La Boétie n’est pas né de la dernière pluie.
Puis l’on vous donne pour festin la foire électorale où chaque comédien- candidat, à qui mieux-mieux, se réclamera du peuple, ce peuple qui ne se trompe jamais. L’histoire en est la preuve. J’ai entendu : « peuple français », je ne mens pas. Je n’ose pas dire les autres outrances à la raison que j’ai pu également entendre, mes oreilles en souffrent encore. Certains peut-être iront élire des individus que l’on sait pourtant fragiles. Qui confierait son enfant ou sa vieille mère malade à un politicien ? Quelle confiance avoir en un être humain prétendant me gouverner quand je ne demande rien? De quel droit m’imposerait-on d’être gouvernable et donc de renoncer à ma liberté ?
Ce besoin de pouvoir, cette cécité totale sur le monde, cette inconstance de la raison et ce déni de responsabilité dont font preuve ces gens là ne sont-ils pas les symptômes d’une quelconque maladie mentale ? Il est vrai que ce sont eux qui dictent les manuels de psychiatrie, et étrangement ils n’y parlent pas d’eux, pour une fois…
Le pouvoir est si pleutre qu’il se délaie, comme une gouache. L’homme (il s’agit surtout d’hommes) s’affirme, déploie des idées qu’il n’a pas, des projets dont il n’a que foutre, des idéaux qu’il a déjà trahi ; sa bureaucratie affirme sa « ligne » et se liant avec d’autres pouvoirs plus discrets, proxénètes, trafiquants, financiers de tous étages. Le pouvoir adore l’intérêt général ; mais général ne veux pas dire commun, nuance ! C’est un intérêt généralement partagé en général par ceux qui en ont intérêt. En tout cas, ça n’est pas le mien et j’ai bien peur, lecteur, que ça ne soit pas le tien non plus.
Alors que reste t-il à rêver ? Tout est laid, le pouvoir s’est immiscé dans le moindre ru de la société, la hiérarchie des malheurs sert de canevas aux haines à venir, il faut se battre contre plus pauvre que soi, il faut haïr ou jalouser. Jalouser le quignon de pain, même la compassion. Surtout ne pas penser, réfléchir, juste laisser aller sa rancœur de n’être pas plus fort, plus riche ou plus envié.
Des bombes s’abattent ici ou là, des gens se suicident au travail, des femmes vendent leurs corps, des gens très croyants saupoudrent de coke leurs toasts au caviar dans des îles privées. Les dieux ont bonne presse pour certains, beaucoup moins pour d’autres mais on sait que c’est une histoire de mode. Non, il ne reste plus rien à rêver que sa vie en se disant très fort et très souvent que c’est celle que l’on a choisi, en toute liberté. C’est en toute liberté par exemple que je n’habite pas Alep, que je suis un salarié bien payé, que je ne suis pas à la rue. En toute liberté, je me lève chaque matin à six heures et je marche dans le vent glacial, sourire aux lèvres, pour passer la journée à faire des choses inutiles pour moi comme pour les autres. Je suis tellement libre que je peux en douter, ce qui n’est pas raisonnable.
Alors que reste t-il à rêver ? Tout est laid. Mais le pouvoir a ses limites, celles que lui donne notre puissance. Cette puissance qui fait que parfois on se soulève, on monte des barricades, on entonne des chants, on fait des manifs. On dit très fort que pour les crises, les catastrophes, les fléaux, on est là, mais pas seul. Comme une meute affamée de dignité, on se bat pour un idéal, avec la puissance que donne la solidarité, cette certitude de ne jamais être seul. Le pouvoir oppose, classe contre classe quand la puissance explose. Et on n’en a pas fini des révolutions et des révoltes. C’est dans le sang de la raison.
Quid lucrum istic mihi? Celui de ne pas me lever le matin peut-être, celui de passer la journée à faire des choses utiles à moi et aux autres, d’être de ceux qui peuvent avoir en lieu et place du pouvoir, la puissance de la vie. De ne plus feindre mon sourire à six heures du matin quand je marche dans le vent glacial. « L’espérance des lendemains, ce sont mes fêtes » disait Rutebeuf et Gramsci aurait ajouté du fond de sa cellule, « pessimiste par raison, optimiste par volonté ».
Que vivent les révolutions sociales et libertaires !Que vivent les révolutions sociales et libertaires !
Article écrit le 16/12/16